
Table ronde n° 2
Inclusion professionnelle des personnes en situation de handicap
Table ronde animée par des professionnels de l’Association IES.
Avec les témoignages de Monsieur Jean-Jacques CHOVET, DRH de Renault Trucks Défense et de Monsieur Antoine MASSELIER, PDG de Lars Traiteur.


Le handicap, une compétence pour les entreprises
Les Établissements et Services d’Aide par le Travail (ESAT) accueillent 120 000 adultes handicapés répartis sur 1 400 ESAT et emploient 35 000 professionnels. Depuis le milieu des années 1990, ils subissent à la fois un durcissement de leurs conditions concurrentielles et une augmentation des exigences de qualité de la prise en charge en liaison avec la mise en place des lois de 2002 et de 2005 portant rénovation du secteur médico-social.
Comment les établissements parviennent-ils à concilier les objectifs économiques de rentabilité et leurs missions médico-sociales ?
Au-delà de ces transformations de fond que sont la réduction de la dotation à la place versée par l’Eta, la volonté législative d’améliorer l’insertion sociale et professionnelle des travailleurs handicapés, des évolutions plus récentes ont aussi marqué l’environnement des ESAT, tant sur le plan économique que médico-social.
Sur le plan économique, les délocalisations industrielles des années 1990 ont conduit à une perte de marchés pour les ESA, les activités de sous-traitance ayant également été délocalisées. Par ailleurs, certaines activités à faible valeur ajoutée comme l’assemblage ou le conditionnement subissent elles aussi, la concurrence des entreprises des pays d’Europe de l’Est et d’Asie.
Du fait de l’augmentation régulière du nombre d’ESAT, la concurrence entre ESAT devient parfois virulente. Enfin, les exigences croissantes de qualité des services achat des grandes entreprises contraignent les ESAT à réaliser des investissements importants pour acquérir des équipements coûteux et à relever le niveau de compétence des ouvriers. À contrario, la création du Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées (FIPH) en 2005 a ouvert de nouveaux marchés pour les ESAT dans les fonctions publiques d'État et territoriales.
Ces forces de transformation cristallisent la nature paradoxale des ESAT, pris en tension entre pressions économiques et renforcement de la mission médico-sociale d’insertion sociale et professionnelle des travailleurs handicapés. Face à ces anciens et nouveaux défis, le modèle historique et dominant de l’ESAT, organisé autour d’ateliers de sous-traitance industrielle et de marchés locaux est fragilisé, à la fois par les mutations économiques et par les accusations récurrentes de ghettoïsation des personnes handicapées.
Quelles sont les stratégies mises en œuvre par les établissements pour réagir à ces transformations de leur environnement ?
La circulaire interministérielle du 8 décembre 1978 a défini la double finalité économique et médico-sociale des CAT : « Tout en étant juridiquement des établissements sociaux (...), les centres d’aide par le travail sont simultanément une structure de mise au travail (ils se rapprochent à cet égard d’une entreprise) et une structure médico-sociale dispensant les soutiens requis par l’intéressé et qui conditionnent, pour lui toute activité professionnelle. ».
Depuis lors, les directeurs d’établissement ont manifesté leurs difficultés à tenir un équilibre entre d’un côté, la mission de délivrer des prestations d’éducation, de formation et d’accompagnement et de l’autre, la nécessité de proposer une offre compétitive sur un marché concurrentiel.
Il convient de noter qu’environ 1 % des effectifs des ESAT vers le milieu ordinaire peut naturellement signifier que les établissements sont bien adaptés aux besoins et aux projets des personnes accueillies, ce qui est le cas pour beaucoup et sans doute la majorité des travailleurs des ESAT, notamment, mais pas seulement parmi les plus âgés d’entre eux.
Mais, l’analyse doit être prolongée à la lumière de deux évolutions importantes qui caractérisent les populations accueillies en ESAT :
- depuis plusieurs années, la population en ESAT se diversifie sensiblement et actuellement 37,5 % des personnes accueillies ont des troubles psychiques contre 18,9 % en 2006 ;
- par ailleurs, on constate une évolution des mentalités et des aspirations des jeunes handicapés, et ce, quelle que soit leur déficience. Après une scolarité en partie ou totalement en école ordinaire, et non plus exclusivement en établissement, ces jeunes et leur famille, « la génération de la loi 2005 », sont nombreux à espérer pouvoir vivre et travailler au plus près de tous et, si possible, en milieu ordinaire.
Devant ces changements que l’on peut déjà observer sur le terrain et qui ne feront sans doute que se confirmer et s’accélérer dans les années à venir, une réflexion plus soutenue et plus volontariste s’impose pour que les efforts déjà entrepris par les équipes professionnelles du secteur se poursuivent et s’amplifient pour mieux répondre à ces nouvelles aspirations qui s’expriment. Il s’agit ainsi de trouver les voies et les moyens d’accompagner « le travailleur handicapé dans ses démarches vers l’extérieur et dans son apprentissage des codes sociaux ».
Fort de son expérience, l’ESAT de la Mare Savin a su réadapter son activité pour sortir de la logique de sous-traitance en développant quatre pôles de compétence répondant aux exigences des entreprises privées et publiques :
• pôle de compétence Blanchisserie industrielle ;
• pôle de compétence Espace vert & Décoration florale ;
• pôle de compétence Restauration, séminaires et traiteurs ;
• pôle de compétence Sous-traitance aux entreprises.
Faute d’inclusion des personnes en situation de handicap en milieu ordinaire, l’ESAT de la Mare Savin a développé avec les entreprises une démarche de détachement de travailleurs seuls ou accompagnés. C’est ainsi que nous avons pu offrir, depuis 2013, à plus de 75 % de travailleurs sur 145 accueillis, des possibilités d’immersion au sein du milieu ordinaire.
Inscription à la table ronde n° 2
Afin de préserver la qualité des échanges lors de ces tables rondes, le nombre de place est strictement limité.
Pour vous y inscrire, merci de nous contacter soit par téléphone au 01 30 50 22 56, soit par mail à l’adresse : association-ies@wanadoo.fr
Découvrez les deux autres tables rondes !
Table ronde n° 1 : " La configuration contemporaine du monde associatif "
Table ronde n° 3 : " Personnes âgées et personnes handicapées vieillissantes "
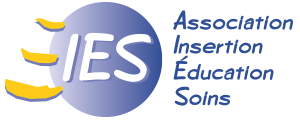

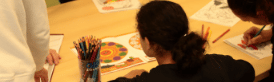
 Unité mobile
Unité mobile Services
Services Établissements
Établissements Logements inclusifs
Logements inclusifs